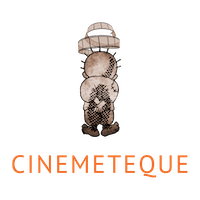« L’immigration n’a pas été pour nous un long fleuve tranquille », ITW de José Vieira
Propos recueillis par Carlos Viana pour le festival Os filmes do homem (Les films de l’homme).
 Vous avez dédié beaucoup de vos films aux immigrés portugais en France. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de leur donner la parole ?
Vous avez dédié beaucoup de vos films aux immigrés portugais en France. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de leur donner la parole ?
Je savais, pour l’avoir vécue en direct, que l’immigration portugaise avait été un exode violent. J’étais enfant mais je me souviens parfaitement des odyssées que racontaient les gens au bidonville pour venir en France, des escroqueries des passeurs, des employeurs et tous ces escrocs qui profitent de la misère et de l’ignorance. J’accompagnais parfois mon père dans les administrations pour servir de traducteur et je voyais bien le mépris avec lequel il était traité.
Bref, l’immigration n’a pas été pour nous un long fleuve tranquille.
Et puis, avec le temps, s’est construit le mythe d’une immigration portugaise qui, au contraire d’autres immigrations, se serait adapter à la France sans le moindre problème. Ainsi on a évincé la dimension douloureuse et conflictuelle de cette histoire. Comme le disait Pierre Bourdieu, la France “ne se pose le problème des immigrés que lorsque les immigrés lui posent des problèmes ». Et, comme les gens heureux n’ont pas d’histoire, les Portugais n’auraient donc rien à raconter. Vous imaginez bien que ce discours niant l’Histoire, ce “storytelling” comme on dit aujourd’hui, était insupportable pour nous, enfants d’immigrés.
Ce qui me semblait primordial dans un premier c’était de raconter pourquoi les gens étaient partis du Portugal et pourquoi ils débarquaient en France dans de telles conditions. Alors je suis parti à la recherche de ces odyssées clandestines entendues au bidonville comme quelqu’un qui court après ses souvenirs d’enfance et qui s’imagine que c’est en confrontant nos récits à ceux des autres qu’on retrouve une mémoire collective et que notre histoire s’écrit.
 En 2001, j’ai réalisé le film La photo déchirée. Jamais je n’aurais imaginé alors que le voyage dans cette histoire se prolongerait si longtemps. Alors pour répondre à votre question, je n’ai pas senti la nécessité de donner la parole aux immigrés portugais car je ne suis pas extérieur à cette histoire. J’ai senti le besoin vital qu’on prenne la parole pour déconstruire un discours dominant qui fabriquait l’oubli, pour tenter d’esquisser une mémoire collective et une histoire commune à ceux qui ont fui le Portugal dans les années 60 et à tous les immigrés d’où qu’ils viennent. Avec en tête, une idée simple : l’immigration révèle le système capitaliste dans toute son injustice et sa rapacité. Pour preuve, des journaux français qui enquêtaient sur les immigrés dans les années 60, titraient sur “Les esclaves des temps modernes” et sur “La traite des pauvres”. Même Paris Match titrait sur le « Trafic des Portugais ».
En 2001, j’ai réalisé le film La photo déchirée. Jamais je n’aurais imaginé alors que le voyage dans cette histoire se prolongerait si longtemps. Alors pour répondre à votre question, je n’ai pas senti la nécessité de donner la parole aux immigrés portugais car je ne suis pas extérieur à cette histoire. J’ai senti le besoin vital qu’on prenne la parole pour déconstruire un discours dominant qui fabriquait l’oubli, pour tenter d’esquisser une mémoire collective et une histoire commune à ceux qui ont fui le Portugal dans les années 60 et à tous les immigrés d’où qu’ils viennent. Avec en tête, une idée simple : l’immigration révèle le système capitaliste dans toute son injustice et sa rapacité. Pour preuve, des journaux français qui enquêtaient sur les immigrés dans les années 60, titraient sur “Les esclaves des temps modernes” et sur “La traite des pauvres”. Même Paris Match titrait sur le « Trafic des Portugais ».
Vous êtes parti pour la France en 1965 à l’âge de sept ans. Votre histoire personnelle et votre expérience en tant qu’immigré ont-elles influencé votre activité de réalisateur ?
Mon expérience d’immigration a plus qu’influencé mon activité de réalisateur, elle l’a créé. C’est parce que je voulais raconter par où nous étions passé que je suis devenu réalisateur. Mais l’immigration ne se résume pas à celle que j’ai vécu.
J’ai travaillé sur d’autres immigrations en France au 20ème siècle comme celles des Italiens, des Russes, des Polonais et plus récemment sur les Roms de Roumanie. Avec toujours le souci d’inscrire ces récits d’immigration dans la durée historique, dans l’Histoire sociale et politique. Il n’a jamais été question pour moi de faire des films communautaires. A ceux qui évoquent mes “films sur les Portugais”, je réponds que je fais des films sur l’immigration avec des gens qui viennent du Portugal. Ce n’est pas un détail, c’est un refus de m’enfermer dans ma propre histoire et de partir d’elle pour aller vers les autres. Car, plus que jamais, notre histoire résonne dans l’actualité. Les récits des voyages des Portugais vers la France dans les années 60 nous plongent dans l’actualité d’un monde où les hommes risquent leur vie pour fuir la misère. Des africains meurent noyés en traversant le détroit de Gibraltar. Des chinois meurent étouffés dans des camions. Quelle différence entre un paysan portugais qui fuyait sans passeport en 1965 et un paysan chinois qui débarque sans papiers en France en 1995 ? Au départ, leur projet est de conjurer la pauvreté et de vivre dans la dignité, rien d’autre.
 Dans le film “La photo déchirée”, vous partagez les mémoires de beaucoup de Portugais qui sont partis en France clandestinement. Dans quelle mesure cette émigration clandestine était une rupture avec le Portugal ?
Dans le film “La photo déchirée”, vous partagez les mémoires de beaucoup de Portugais qui sont partis en France clandestinement. Dans quelle mesure cette émigration clandestine était une rupture avec le Portugal ?
L’émigration clandestine vers le nord de l’Europe dans les années 60, est l’exode le plus massif et brutal que le Portugal ait connu dans son histoire. Elle a vidé des villages entiers dans certaines régions du Portugal. C’est d’abord une rupture dans l’histoire que Salazar prétendait écrire en tenant l’épée dans une main et la charrue dans l’autre. C’est un événement politique sans précédent, “un plébiscite par les pieds” contre le régime, qui a obligé le Portugal à se tourner vers l’Europe.
Entre 1960 et 1970, nous fûmes 1 400 000 Portugais à fuir le pays. Car il s’agit d’une véritable fuite, vécue d’abord comme une rupture non pas avec le Portugal mais avec le régime de Salazar, la misère et la guerre. Bien-sûr, c’est douloureux d’émigrer et de partir vers l’inconnu. Mais peu nombreux étaient ceux qui imaginaient alors que c’était un départ définitif. Car cette émigration porte en elle l’imaginaire de ceux qui sont obligés de s’en aller à la recherche d’une vie meilleure : partir, devenir, revenir.
C’était une évasion (l’émigration est alors considéré comme un crime) pour quelques années, le temps de se libérer de la pauvreté et de la guerre. L’espoir de revenir au pays natal a atténué la violence de l’exil, jusqu’au moment où, quelques années plus tard et parfois trop tard, les immigrés se sont aperçu que le retour était impossible.
La rupture avec le Portugal se situe quand les gens prennent conscience qu’ils sont condamnés à rester en France et qu’on n’émigre jamais impunément. Cette rupture-là chaque immigré peut la dater dans son histoire.
Un jour, j’ai demandé à ma grande soeur si le voyage pour la France avait été pour elle une rupture. Non, elle situait la rupture lorsque trois ans plus tard nous sommes retournés pour la première en vacances au Portugal. Elle, adolescente, qui avait tant rêver de revenir à ces anciens amours, ne se reconnaissait plus dans ce pays engoncé dans le passé. Elle comprit alors que son avenir était en France.
 Dans votre documentaire « Le pays où l’on ne revient jamais » vous interrogez votre père sur les premières années en France. Comme beaucoup d’immigrés il a tendance à s’enfermer dans le silence. Une tentative pour effacer la mémoire de ces temps difficiles ?
Dans votre documentaire « Le pays où l’on ne revient jamais » vous interrogez votre père sur les premières années en France. Comme beaucoup d’immigrés il a tendance à s’enfermer dans le silence. Une tentative pour effacer la mémoire de ces temps difficiles ?
Mon père a émigré alors qu’il avait déjà 48 ans. Pour lui, l’immigration fut une véritable “descente aux enfers”. Il n’a pas supporté de devenir brusquement étranger, d’être l’homme qui n’a pas les mots pour se défendre. Il n’a jamais accepté d’être obligé de vivre dans un bidonville, d’être réduit à de la main-d’oeuvre par le “service des étrangers” du ministère de l’Intérieur. Quand il est arrivé à la retraite, c’était en 1980, il est rentré au Portugal avec une petite retraite et n’a plus jamais voulu remettre les pieds en France. Ma mère rêvait de vivre entre là-bas et ici, d’être une grand-mère nomade.
Mais pour mon père, la France était une parenthèse douloureuse qu’il voulait effacer définitivement de sa mémoire. Revenir en France, c’était retrouver une géographie peuplée de mauvais souvenirs. Car les premiers temps de l’immigration furent pour lui, comme pour la plupart des immigrés de sa génération, des années noires. Dépossédés du présent par le mirage du retour, ils ont vécu des années soumises et sacrifiées. Pressés de rentrer au pays, ils se sont laissés dévorer par le travail.
Cette fièvre du retour a laissé des séquelles irréversibles sur les corps et dans les têtes. Les gens se sont épuisés au travail pour se faire une vie meilleure, certains y ont laissé leur santé. Ils étaient alors des immigrés réduits à une force brute de travail. Leurs vies ont été contaminées par le sale boulot.
En 1966, les travailleurs immigrés qui représentaient 18% des ouvriers dans le bâtiment, étaient victimes de 39% des accidents de travail. Il a fallu compenser des salaires de misère par d’innombrables heures supplémentaires dans les usines et sur les chantiers. Aujourd’hui, quand ils parlent de cette époque, j’entends souvent les immigrés dire : « Nous avons été des esclaves ». Quand ils racontent leur immigration, ils parlent de froid, de solitude, d’équations à trop d’inconnues, d’un hiver dans leur vie. Les premières années, les gens, surtout ceux qui habitaient les bidonvilles, ont vécu dans l’angoisse de l’expulsion.
Je me souviens que mon père nous disait toujours que nous n’étions pas chez nous, que le France pouvait nous renvoyer du jour au lendemain. Mais le plus dur pour mon père fut sans doute de “perdre” ses enfants dans cette tourmente qu’est l’immigration. Dans le film, sans la formuler, il nous pose cette terrible question formulée par Abdelmalek Sayad : l’immigration ne provoque-t-elle pas des préjudices sans commune mesure avec les bénéfices économiques qu’elle peut apporter ?
 Dans le film, votre père regrette d’avoir emmené ses enfants en France. Ce sentiment d’amertume dû à l’éloignement familial et provoqué par son retour peut-il être généralisé et entendu comme une des conséquences de l’immigration ?
Dans le film, votre père regrette d’avoir emmené ses enfants en France. Ce sentiment d’amertume dû à l’éloignement familial et provoqué par son retour peut-il être généralisé et entendu comme une des conséquences de l’immigration ?
Oui. L’immigration condamne les immigrés à une suite de ruptures et de séparations. Dans mes tournages, je rencontre des enfants qui ont vécu séparés de leurs parents partis en France, des parents revenus au Portugal qui vivent loin de leurs enfants restés en France. Dans les villages d’émigration, les gens me parlent sans cesse de l’absence. Je rencontre aussi des gens qui sont partis et qui ont refusé de vivre loin de leurs familles, qui n’ont pas supporté le déracinement.
Partis pour se débarrasser de la misère, ils ont refusé de se plier aux servitudes de l’immigration, de s’engager dans la main-d’œuvre étrangère et ils ont « déserté ».
Leurs histoires prouvent la brutalité que les autres ont dû affronter pour sortir de la clandestinité, pour parvenir à avoir des papiers et un logement décent, pour ne pas se faire exploiter. Ce que ces « insoumis » de l’immigration disent raconte la violence faite à ceux qui partent.
Mais l’immigration est faite de paradoxes. Dans Souvenirs d’un futur radieux, le dernier film que j’ai réalisé, je réponds ainsi à mon père quand il dit regretter de nous avoir emmenés en France : “Tu m’as toujours dit que l’erreur de ta vie, c’était de nous avoir fait émigrer. Non, tu as fait ce que tu devais faire, ce qu’un père doit faire pour ses enfants. Tu nous as sauvé d’une redoutable dictature, d’une guerre coloniale, d’un pays où seul le passé semblait présent.”
 Dans la voix off vous dites : “On ne revient jamais au pays que l’on a quitté”. Le retour qui était le rêve des immigrés semblent se transformer en un nouveau dilemme, une nouvelle rupture ?
Dans la voix off vous dites : “On ne revient jamais au pays que l’on a quitté”. Le retour qui était le rêve des immigrés semblent se transformer en un nouveau dilemme, une nouvelle rupture ?
Le retour, surtout pour les femmes, est souvent une rupture plus violente que ne le fut le départ pour la France. Imaginez que vous passez toute votre vie à travailler comme un forcené pour le retour et qu’au moment où vous pouvez enfin réaliser votre projet, vous prenez conscience que ce n’est plus possible. Les immigrés découvrent alors que l’immigration engendre des rêves impossibles parce qu’elle porte en elle l’absence qui détruit les liens avec le lieu où ils étaient censés se réaliser. Le désenchantement est terrible. Cette utopie des immigrés qu’est le retour, et qui avait donné un sens à leur vie, s’effondre. Etaient-ils aveuglés à ce point par le mythe du retour pour ne pas se rendre compte de la difficulté de revenir après tant d’années ?
Dans cette situation dramatique (des gens tombent en dépression, parfois se suicident) les immigrés sont incapables de percevoir la réalité autrement que sous la forme d’un univers fracturé. Il n’y a pas pour eux de « continuité territoriale » entre l’émigration et l’immigration, entre la France et le Portugal. Ces deux mondes, que leur expérience aurait dû rapprocher, s’éloignent au fur et à mesure que le temps passe et qu’ils vieillissent. Ils souffrent de n’être nulle part à leur place et partout déplacés. Certains d’entre eux vivent maintenant en transit, ballottés entre les deux pays. Pour atténuer cette double absence, ils essaient d’être dans un perpétuel voyage. Arrivés à la retraite, ils n’arrivent pas toujours à se fixer, alors beaucoup font des allers-retours entre les deux pays. Condamnés à errer entre deux mondes, ils rêvent d’en cumuler les avantages : ils rêvent d’une France qui serait une autre terre natale et d’un pays d’origine qui serait une France idéalisée, comme le dit si bien Abdelmalek Sayad.
 Dans « Chronique de la renaissance d’un village » les immigrés ne pensent plus au retour et ils racontent les difficultés d’arriver et de reconstruire une vie dans un village en ruine. Grâce au travail de ces immigrés, La Roche Blanche et d’autres villages d’Auvergne ont été sauvé de la ruine. Est-ce là un bon exemple d’intégration dans la société française ?
Dans « Chronique de la renaissance d’un village » les immigrés ne pensent plus au retour et ils racontent les difficultés d’arriver et de reconstruire une vie dans un village en ruine. Grâce au travail de ces immigrés, La Roche Blanche et d’autres villages d’Auvergne ont été sauvé de la ruine. Est-ce là un bon exemple d’intégration dans la société française ?
Je pense qu’il faut éviter de parler de bons ou mauvais exemples, parlons plutôt d’expériences d’intégration. Malgré les difficultés posées par l’arrivée d’un grand nombre de familles portugaises dans les années 60, ces villages ont été le théâtre d’une étonnante expérience d’intégration d’étrangers à la société française. Mais une intégration « réussie » a ses exigences.
Le maire et instituteur de la Roche Blanche qui, en 1973, annonce à la télévision qu’il y a 67% d’enfants étrangers dans son école, ne le fait pas pour dénoncer leur présence mais pour dire qu’il entend relever le défi de leur avenir dans le village. Il sait alors que leur présence est essentielle pour l’avenir de la communauté dont il est l’élu. Pour les Portugais qui vivent depuis cinquante ans dans ces villages, la conscience d’être les principaux responsables de ce sauvetage est très vive et se transmet d’une génération à l’autre. Leur arrivée fut une période difficile marquée par un travail harassant, mais en même temps une véritable épopée qui les a définitivement enracinés.
Ce sentiment fort d’appropriation des lieux a déterminé un mode de sociabilité original pour ces familles qui contraste avec ce que l’on observe en général dans l’immigration portugaise. Elles n’ont pas cherché à transférer dans leurs villages d’adoption un mode de vie et des pratiques sociales importées des campagnes qu’elles avaient quittées. Elles n’ont pas cherché à réduire ces villages en voie d’abandon à n’être que le support d’une vie communautaire repliée sur elle-même.
 Dans le même film, certains immigrés disent qu’il continue à exister de l’incompréhension et même une certaine xénophobie. Durant le tournage du documentaire, avez-vous senti chez les gens que vous avez filmé des stigmates de cette exclusion, de cette difficulté d’appartenance à un endroit, à une société ?
Dans le même film, certains immigrés disent qu’il continue à exister de l’incompréhension et même une certaine xénophobie. Durant le tournage du documentaire, avez-vous senti chez les gens que vous avez filmé des stigmates de cette exclusion, de cette difficulté d’appartenance à un endroit, à une société ?
Je commencerais à répondre à cette question, par une interrogation : pourquoi, alors que l’ont dit ces immigrés si bien intégrés, leurs enfants et les petits-enfants ont-ils tellement besoin de se revendiquer « Portugais » ?
Si la question se pose c’est qu’il y a malaise. Et ce malaise, je l’ai senti tout au long du tournage.
La plupart des habitants que j’ai interrogés avait un regard lointain et paternaliste quand ils parlaient des Portugais qui vivent avec eux depuis cinquante ans. Ils ne connaissaient rien de leur histoire, du pays d’où ils venaient. La réponse à mes questions était toujours la même : « Tout s’est très bien passé, ils sont travailleurs et courageux, ils savent rester à leur place ». Et « rester à sa place », ça veut dire taire son histoire et se faire discret. Pour s’adapter les immigrés ont déployé une « stratégie d’évitement » dont ils avaient l’habitude avec la dictature au Portugal. Mais ne pas en parler publiquement ne signifie pas qu’on a rien à dire mais juste que les gens gardent ça en eux, “comme une blessure” comme le dit un homme dans le film. Bien-sûr, une arrivée aussi massive d’immigrés a posé des problèmes. Toute immigration provoque des conflits. Quand les immigrés arrivent en nombre, ceux qui les voient débarquer se sentent envahis. L’immigration portugaise n’échappe pas à la règle. C’est ce que certaines personnes disent dans le film.
 Un des personnages dit : “Mon pays est ici, je suis Français, je me sens Auvergnat”. Comment interpréter ces sentiments et ces choix ?
Un des personnages dit : “Mon pays est ici, je suis Français, je me sens Auvergnat”. Comment interpréter ces sentiments et ces choix ?
D’une manière très simple. Nous pensons, nous rêvons et nous nous exprimons en Français. Alors quoi de plus naturel que de dire que notre pays c’est la France. Mais une question subsiste : comment se sentir “Français », après avoir été si longtemps discriminés parce qu’étranger ?
Propos recueillis par Carlos Viana pour le festival Os filmes do homem (Les films de l’homme)
|
|
|
|