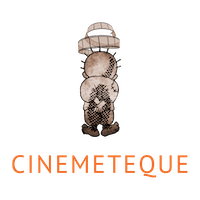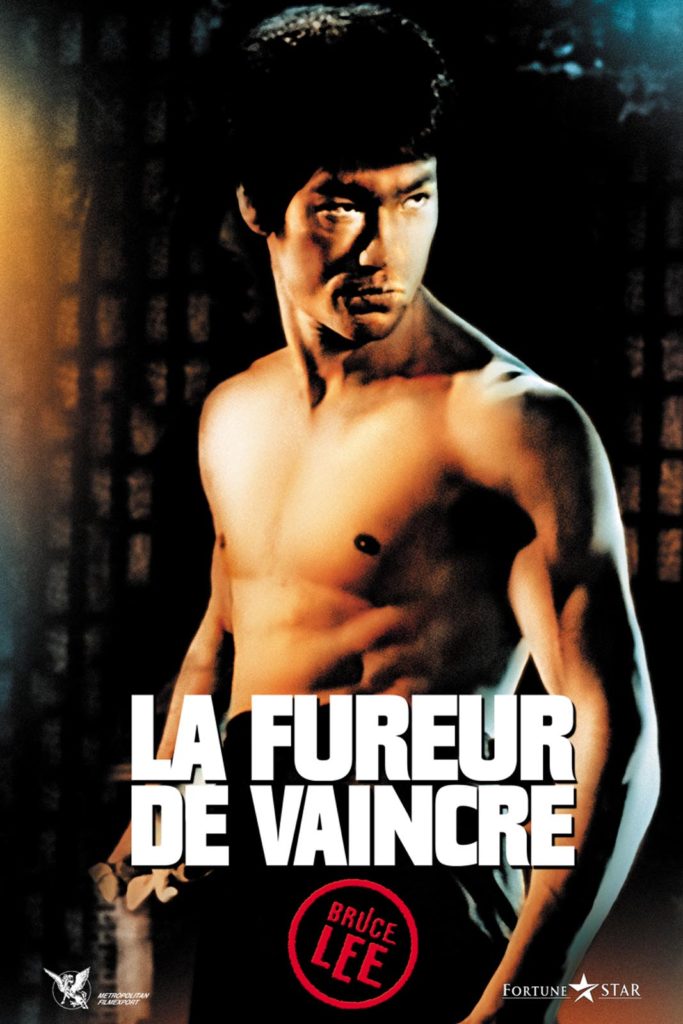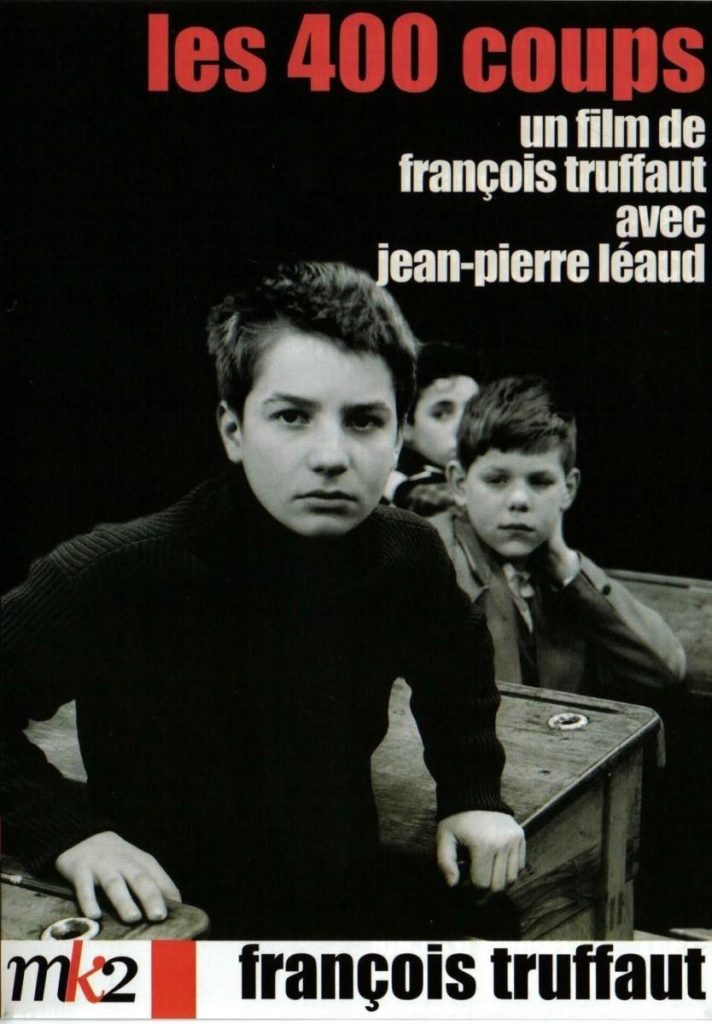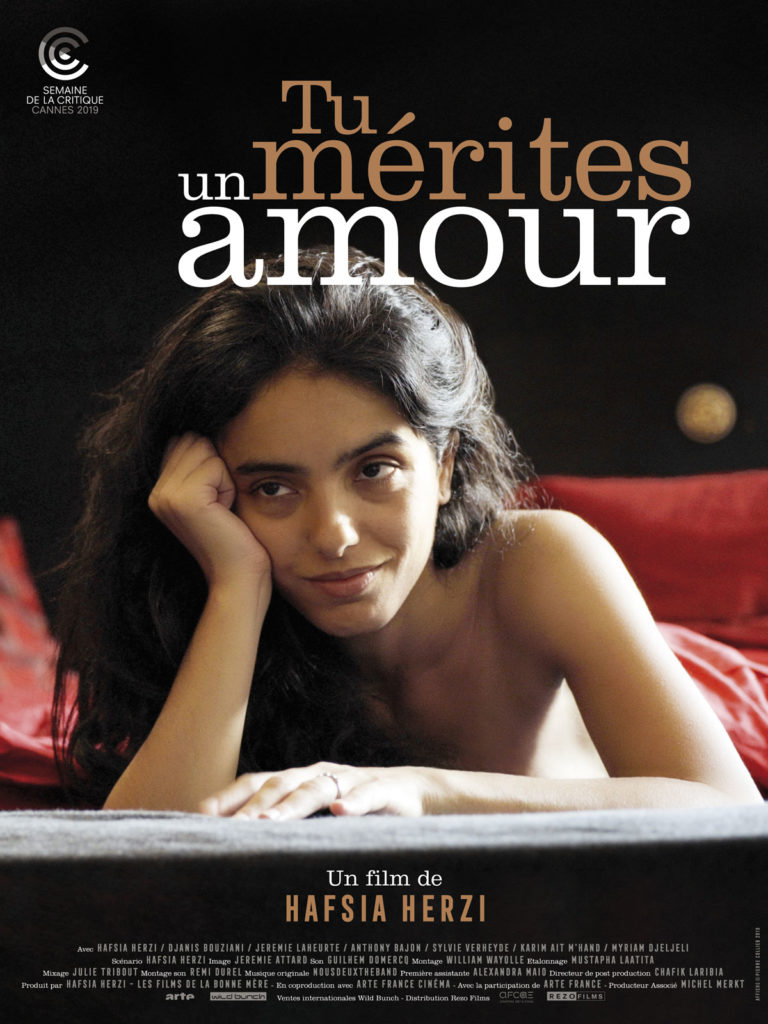MYRIEM TENFICHE
Biographie
ARTISTE-PEINTRE
Je me souviens de la première fois que je suis entrée dans une salle de cinéma. J’avais 10 ans. Jim Carrey avait la cote et une petite salle à Montparnasse repassait Ace Ventura. C’était ma grande sœur Sabrina, alors âgée de 16 ans, qui tenait à m’y emmener. Elle s’en était fait un devoir : sa petite sœur devait entrer au cinéma avant d’entrer au collège. Moi je ne comprenais pas pourquoi on devait se déplacer pour aller voir un film. Un film ça se regardait en famille dans le salon, pas avec des inconnus ! Et puis, pourquoi fallait-il payer ? La même année, je me souvenais qu’au centre de vacances, il y avait une salle-télé avec des cassettes vidéos, avec ces fameuses petites chaises en bois ou bien celles en plastiques. C’était gratuit, bruyant et inconfortable.
Mais en entrant pour la première fois dans une salle de cinéma, stupeur et excitation ont marqué ma mémoire. J’ai compris que j’allais vivre quelque chose de spécial. Dès que les bandes annonces ont commencé, j’avais les yeux écarquillés, j’étais éblouie par la taille de l’écran et par le son qui était fort et qui venait de partout. Quand le film a commencé, j’étais alors hypnotisée par ce que je voyais. Je me souviens aussi que ma sœur m’avait engueulée à voix basse parce que je parlais fort et qu’elle était très en colère que je lui dise en plein milieu du film que j’avais envie de faire pipi…
En sortant du cinéma, j’étais fière. J’avais l’impression d’avoir vécu une expérience hors du commun. Je pouvais enfin aller à l’école et dire à mes camarades que moi aussi j’avais été voir un film ! Quand ils me racontaient les derniers Disney qu’ils allaient voir avec leur parents, je ne comprenais rien et j’ignorais tout de ces princesses qui ornaient leur cartables, leurs trousses et leurs sandales. Enfin j’allais pouvoir crâner à mon tour en racontant l’histoire de mon héros Jim Carey sous les traits d’Ace Ventura, détective pour animaux.
Plus tard, j’ai compris que c’était un devoir de grande sœur qui avait été honoré ce jour là pour conjurer le sort. Le sien. Petite déjà, Sabrina était fascinée par les images des affiches des films qui pullulaient dans le quartier des cinémas à Montparnasse, près duquel nous habitions. Elle ne comprenait pas de quoi il s’agissait. Elle trouvait ces affiches magnifiques et chacune d’elles lui racontait une histoire qui se laissait imaginer. Mais elle, personne ne l’avait emmenée par la main pour lui montrer. Ce n’est qu’à 15 ans que ma sœur, qui est aujourd’hui scénariste/réalisatrice, a fait son baptême du cinéma. Au collège c’était la « loose » de ne pas avoir vu les derniers films dont tout le monde parlait et de ne pas connaître les stars qui inspiraient tous les ados. Si vous n’aviez pas vu The film, vous ne pouviez pas participer aux discussions passionnées. Vous étiez à coté de la plaque. Pire c’était la honte grave de dire qu’on avait jamais été au cinéma. On passerait pour un gros pauvre inculte, voir pour un extraterrestre. Qui aurait envie de nous fréquenter ? C’est aussi ça la honte sociale…
Notre famille était un petit « cocon », un lieu rempli d’amour mais avec très peu d’argent. Nous étions 5 enfants et les problèmes de santé de mon père n’arrangeaient rien. Ouvrier boulanger en arrêt maladie depuis quelques années, il était très fier de nous raconter qu’à l’époque où il vivait à la casbah d’Alger avec ma mère, il avait eu l’audace et la modernité d’emmener sa femme au cinéma et au théâtre ! Lui qui arrivait de sa montagne et qui n’avait jamais pu aller à l’école.
Mais mon père n’avait plus les moyens de nous emmener où que ce soit. Le weekend, on allait à la bibliothèque municipale pour lire des bandes dessinées. On squater le parc, où on se défoulait à la balle au prisonnier, au chat perché et autres classiques du genre. On se retrouvait entre enfants d’immigrés du quartier. Ensemble, on ne se sentait pas bizarre, on était à l’aise, on se comprenait. Nous étions les seuls gamins à avoir autant de temps libre à dilapider. Les autres enfants passaient peu de temps dehors, ils étaient sous la haute surveillance de leurs parents et nous parlaient toujours de trucs qu’on ne connaissait pas. Nous, on faisait ce qu’on voulait. Comme dans les villages de nos parents, les plus grands avaient la responsabilité des plus petits et on rentrait chez nous le soir pour manger alors que nos camarades de classe devaient déjà dormir. Je vous laisse imaginer mon émoi quand j’ai vu pour la première fois Les 400 coups de Truffaut. J’ai commencé à comprendre ce qu’était le cinéma. Que ça pouvait aussi parler de moi, de nous.
Ceci étant dit, je n’ai pas beaucoup fréquenté les salles de cinéma entre mes 10 et mes 19 ans. Cependant quand j’étais petite il y avait du cinéma Chinois à la maison. Les films d’art martiaux de Bruce Lee et Jackie Chan. Mon père et mon frère en raffolaient.
Quand il était jeune, pour tuer le temps, mon père faisait de la boxe à Alger dans le quartier de Bab El Oued. Il travaillait dans une boulangerie place des Martyrs. Il était pauvre. Il ne pouvait compter sur personne pour le sortir d’une mauvaise passe. Il lui arrivait de ne pas manger et il dormait sur les sacs de farine ou sur la plage où il flânait en chantonnant des airs de Matoub Lounès. Il y a quelque temps, je l’ai entendu dire à ma mère fier comme un algérien : « Quand on sera à Alger je t’emmènerais dans la salle de boxe où j’allais quand j’étais jeune. Je suis sûr qu’ils ont encore ma photo au mur. J’étais le plus fort ! Ils avaient tous peur de moi ces voyous qui cassaient la gueule aux débutants « messaquine » (NDLR : « les pauvres »). Mais moi je ne les laissais pas faire. » J’ai vu ma mère qui était dans une autre pièce faire un tout petit sourire en coin qui telle la pointe d’un iceberg laissait entrevoir la profondeur pudique de leur amour, après 52 ans de mariage… Moi quand je l’ai entendu dire ça, j’ai imaginé mon père jeune et beau comme Alain Delon dans Rocco et ses frères.
Dans La Fureur de vaincre, Bruce Lee se fait rejeter d’un parc tenu par des japonais. Une pancarte annonce « Interdit aux chiens et aux chinois ». Humilié par des japonais qui lui proposent de le mettre en laisse pour le faire rentrer, il fait voler la pancarte au ciel et l’explose d’un coup de pied sauté. De famille modeste, on s’identifiait immédiatement aux films de Bruce Lee. C’était toujours le faible ou le pauvre qui allait gagner contre le fort, contre l’oppresseur. On ressentait une grande fierté. Mon frère qui est aujourd’hui coach pour des champions de boxe, idolâtrait Bruce Lee et voulait être le plus fort du quartier. Mon père, grand karatéka, quand à lui apprenait à ses filles, au milieu du salon, des clés de bras et autres techniques d’auto-défense.
À 19 ans, je suis monté dans le Nord. Dès que j’ai été en possession d’une bourse d’étude, j’ai réalisé un de mes rêves d’enfance. Je me suis offert la « Golden Card ». La carte UGC illimité ! J’y allais tout le temps. Souvent toute seule. Même si certains trouvaient cela bizarre. Je voulais en profiter au max. Jouir de ce plaisir dont j’avais été privée trop longtemps. Voir Django Unchained un soir d’hiver, au troisième rang, siège du milieu, dans la plus grande salle du seul cinéma de Roubaix, une des villes les plus pauvre de France, peuplée d’enfants d’ouvriers des mines avec la pauvreté comme seul héritage social, c’est quelque chose d’unique. On sort de là la tête haute et on a envie d’être comme Django. Une exception à la règle. Un super héros des pauvres enfants d’ouvriers qui n’y arrivent pas. L’éclaireur qui part devant pour te sortir de ta mine, de ta caverne, de ta condition. Ça ma bouleversée, j’avais la poitrine qui vibrait. C’était il y a 7 ans déjà.
L’année passée, j’ai vu un autre film qui donne des ailes. Qui donne envie de crier de joie. Qui nous influence positivement en montrant l’injustice et la dure réalité de la vie. C’était Green Book : sur les routes du sud. Cette fois ci, je n’ai pu m’empêcher d’applaudir très fort à la fin de la projection. Alors que ça ne se faisait pas au cinéma, j’ai été émue de voir que la salle toute entière m’avait suivie.
Moi aussi il fallait que je brave des interdits liés à ma condition sociale. Que je me déchaine comme Django. Alors j’ai décidé de devenir artiste peintre. Je suis donc entrée au beaux arts de Lille. Je me souviens qu’une année nous n’étions que 4 élèves, sur toute l’école, à être d’origine modeste et africaine. Deux mecs noirs et deux nanas algériennes. Moi qui venait d’un HLM parisien, j’avais appris à m’adapter. J’étais un caméléon. Mais Nadia qui venait d’une cité du nord de la France, c’était plutôt un éléphant dans la pièce. Elle s’habillait comme une caricature de la « jeune de banlieue ». Elle parlait fort, avec beaucoup de mots d’argot et les mains qui gesticulent. Partout ailleurs on l’aurait fui, mais au sein d’une école d’art, elle était appréciée des élèves. Elle était « originale ». Personne ne savait qui elle était vraiment mais elle représentait en elle même une forme de marginalité et de résistance chère aux artistes. Je ne pense pas qu’elle en avait conscience car elle tenait son rôle rassurant de « cancre ». Elle faisait genre qu’elle s’en foutait des cours mais je savais qu’elle habitait hyper loin de l’école et elle était toujours là à l’heure. Un jour, elle nous a complètement bluffés : Elle à présenté pour sa Licence une vidéo-performance dans laquelle elle s’étalait de la cendre noir sur sa peau. Puis elle se recouvrait le corps dénudé de charbon de bois comme si elle s’enterrait vivante, jusqu’à disparaître sous la masse noire ! Moi j’ai été prise à la gorge devant cette vidéo. C’était de l’art. Pur et dur. Ça a fait son petit effet, tout le monde en parlait. Mais Nadia n’a pas eu son diplôme et elle à dû quitter l’école. L’année suivante j’ai commencé à m’intéresser à la présence des femmes dans l’art et aux problématiques féministes.
J’ai fait, il y a quelques années, une sorte d’overdose de la fiction. J’avais besoin de me raccrocher à la réalité et de ne plus vivre les émotions par procuration. Mais il y a 1 an et demi, une autre de mes soeur, Salima, m’a invitée aux Rencontres Cinématographiques de Bejaïa et j’ai renoué avec le cinéma par l’angle du documentaire. J’y ai vu notamment le film La Bataille d’Alger, Un film Dans l’Histoire de Malek Bensmaïl. J’ai enfin compris pourquoi ce film, La Bataille d’Alger, portait en lui quelque chose de sacré. Enfin en 2019, j’ai vu des films qui m’ont bouleversés. J’ai eu la chance de rencontrer les réalisatrices et réalisateurs de ces films. Des gens d’une grande humanité investie intimement dans les causes dont ils nous parlent. Des Figues En Avril de Nadir Dendoune ; Paris La Blanche de Lydia Terki ; De Cendres et De Braises de Manon Ott et Gregory Cohen ; Les Fleurs Amères, d’Olivier Meys ; et Tu Mérites Un Amour de Hafsia Herzi. Chacun de ces films me parlent de femmes extraordinaires. À une époque où il est encore rare de les voir de l’autre coté de la caméra, ces films nous donnent à voir des mères-courages ; des épouses ambitieuses prêtes à tous les sacrifices pour faire vivre dignement les siens ; des citoyennes qui donnent la parole aux opprimés ; des femmes qui revendiquent leur liberté et enterrent les clichés. Des personnages féminins complexes et fabuleux. Des femmes en action.
tenfichemyriem@gmail.com
Mes propositions de films
ROCCO ET SES FRÈRES
Rosaria, mère de cinq garçons, a décidé de quitter la Calabre, cette terre ingrate où elle ne peut subvenir aux besoins de sa famille, , Lire la suite...
LA FUREUR DE VAINCRE
LES 400 COUPS
DJANGO UNCHAINED
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD
LA BATAILLE D'ALGER, UN FILM DANS L'HISTOIRE
DES FIGUES EN AVRIL
Le film Des figues en avril dessine le portrait drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, fil, Lire la suite...